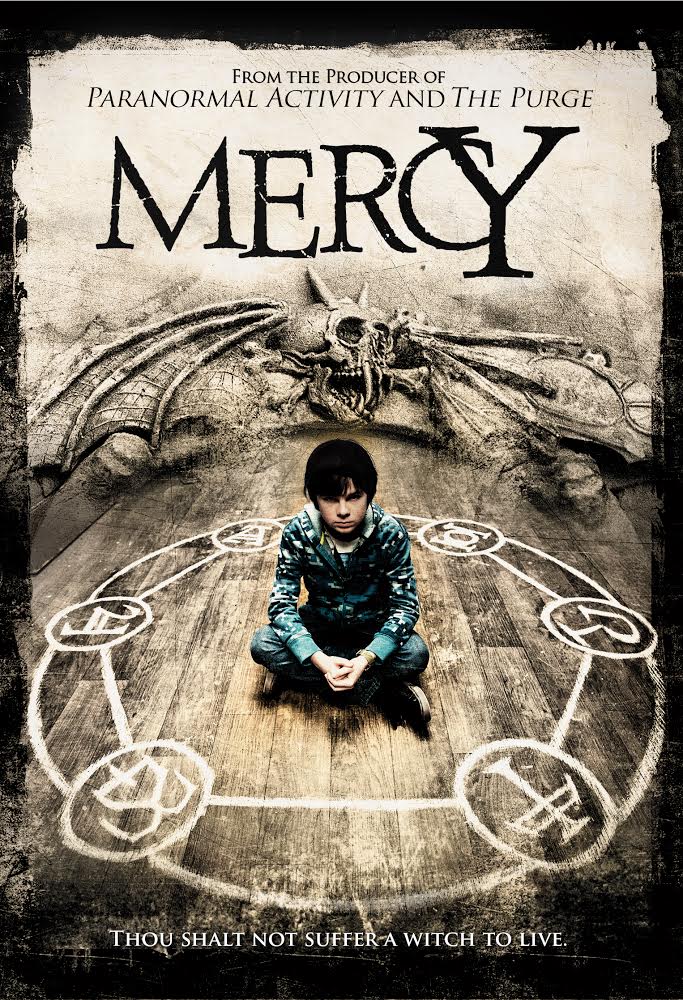La grand-mère de George est aussi sa meilleure amie, jusqu’à ce qu’elle fasse une syncope et développe tous les signes de la possession démoniaque. Mais bon, il faut s’occuper d’elle tout de même, parce que la famille c’est sacré et tout le tralala…
Je m’étonnais hier encore d’être dans une étonnante série de bons films. Quatre ou cinq à la suite, je crois même que c’est un record pour mon blog. Il fallait bien que ça s’arrête, donc voilà : Mercy n’est pas un bon film. On a cru au grand chelem, on avait tort.
Mais pour être tout à fait honnête, ça me changera, Mercy n’est pas non plus une catastrophe atomique. J’ai même espéré quelque chose de vraiment bon au début. La réalisation est tout ce qu’il y a de plus respectable, les acteurs font correctement leur travail, les personnages tiennent debout et on a même droit à quelques petites trouvailles pas désagréables du tout, – je pense notamment à « l’amie imaginaire » de George.
Alors que reproche-je donc ainsi à ce film qu’il a l’air pas si mal dit comme ça ? Sa banalité. Son conformisme. Son grand, pénible, éternel, oppressant conformisme. On regarde un film qu’on a déjà vu mille fois, avec les sursauts ordinaires, avec les retournements de situation classiques, avec les petits effets ironiques conventionnels, et ça dure comme cela jusqu’à la fin. C’est cliché. Et ça ne marche pas.
Mercy, c’est le film « adapté d’une nouvelle de Stephen King » typique. On aurait eu le même dans les années 90, à quelques effets de grammaire près. Avec Edward Furlong à la place de Chandler Riggs, dans le rôle de l’ado à qui on ne la fait pas. Un film que l’on consomme plus qu’on ne le regarde, et qu’on oublie en moins de deux semaines.
Sur ce, je vous laisse.