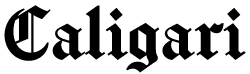Contre les religions : comprendre les combats et leurs enjeux
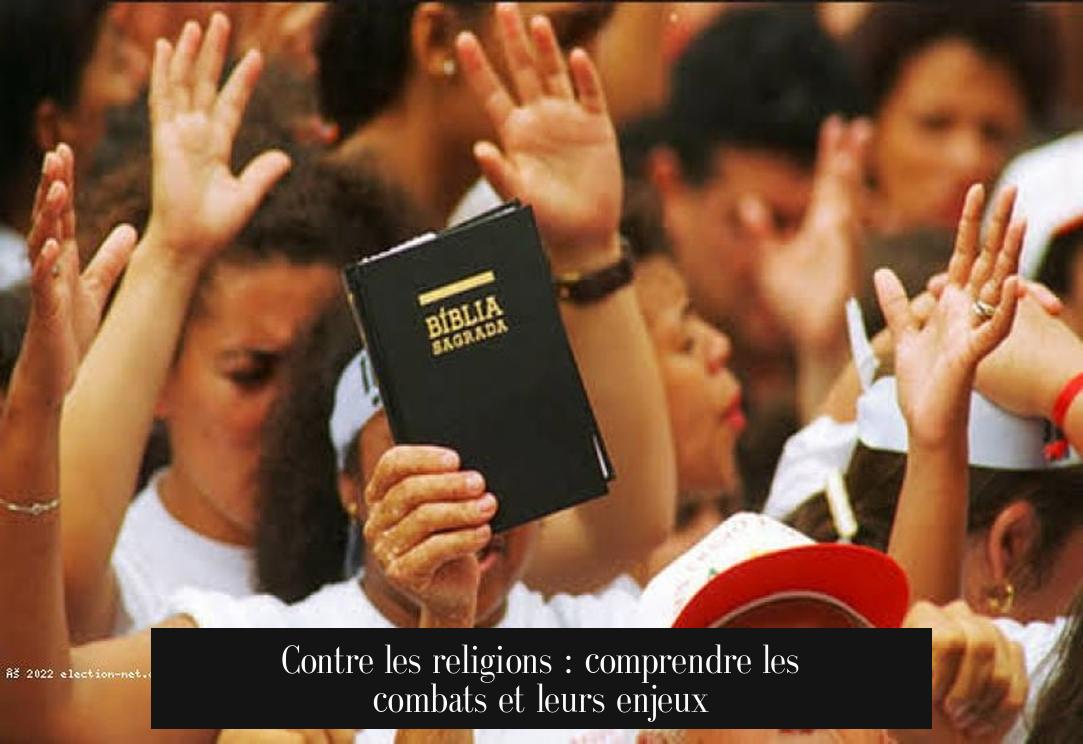
Les violences contre les religions prennent plusieurs formes et reflètent des enjeux politiques, identitaires et sociaux complexes. Ces affrontements dépassent souvent le simple rejet de la foi. Ils mêlent contrôle étatique, lutte idéologique, intolérance identitaire et résistance à l’influence religieuse.
Une lutte multiforme contre les religions
Les religions, diverses par nature, sont victimes de combats variés. Dans certains pays, leurs pratiques et croyances se retrouvent sous la pression d’États totalitaires ou de régimes idéologiques. Par exemple, en Russie soviétique ou en Chine, la foi est perçue comme un obstacle à l’édification d’un « homme nouveau » ou à la modernité portée par l’État.
En Chine, la répression prend plusieurs visages : destruction de lieux de culte, interdiction de fêtes, étroite surveillance des ministres religieux, contrôle renforcé des minorités tibétaines ou ouïghoures. La « sinisation » des religions vise à les réduire à une pratique privée sous contrôle strict, illustrée par la création d’un « catholicisme patriotique » indépendant de Rome.
La religion comme enjeu d’identité et terrain de conflits politiques
- Instrumentalisation politique : La religion est souvent utilisée comme prétexte à des combats politiques. Les groupes extrémistes, comme certaines factions islamistes, manipulent des notions religieuses pour justifier leurs actes. Ils réinventent la tradition pour masquer leurs échecs.
- Intolérance identitaire : Dans un monde où les grandes idéologies déclinent, la religion sert parfois de refuge identitaire intolérant. Ce regard ignore les évolutions modernes des croyances, renforçant une image déformée et figée des religions.
- Négation culturelle : Dans les États autoritaires, la religion est niée dans son rôle culturel et identitaire. La volonté de moderniser exclut et réduit la foi, ce qui provoque souvent des tensions et une résistance accrue des fidèles.
Le cas français : un combat laïque contre l’influence religieuse politique
En France, la lutte contre les religions s’inscrit dans une tradition laïque solidement ancrée depuis la loi de 1905. Cette loi sépare l’Église et l’État et vise à garantir la liberté de conscience tout en limitant l’influence politique et sociale des institutions religieuses.
| Article | Contenu principal |
|---|---|
| Article 1 | Liberté de conscience et liberté de culte garanties. |
| Article 2 | L’État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. |
| Article 4 | Les édifices de culte sont confiés à des associations. |
L’objectif est d’inscrire la loi républicaine au-dessus des institutions religieuses au niveau politique et intellectuel, en reléguant l’Église catholique à un rôle plus discret dans la société.
Lutte internationale contre l’intolérance et la haine religieuse
La haine fondée sur la religion reste une réalité mondiale. L’ONU souligne que les différences religieuses sont souvent instrumentalisées pour justifier discrimination et violences. Les médias sociaux amplifient ce phénomène, propageant la haine à une vitesse inédite.
La résolution 79/180 adoptée en décembre 2024 recommande :
- De créer des réseaux de dialogue et des projets éducatifs favorisant la tolérance.
- D’investir dans la formation des agents publics pour prévenir les conflits religieux.
- De criminaliser l’incitation à la haine religieuse et de lutter contre les stéréotypes négatifs.
- D’assurer la protection des lieux de culte et de promouvoir la liberté religieuse et le pluralisme.
Ces mesures visent un climat plus pacifique où les croyances peuvent coexister sans violence ni exclusion.
Quelques idées reçues sur les religions

Patrick Banon rappelle que les religions n’ont pas créé la violence. Elles vivent au sein de sociétés souvent violentes. La laïcité, loin de rejeter la religion, garantit la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance, tout en organisant un espace public neutre et respectueux.
Points essentiels à retenir
- Les violences contre les religions sont diverses : elles vont des répressions étatiques aux manipulations politiques et aux discriminations sociales.
- La religion est souvent prise en otage : elle sert de prétexte à des combats identitaires et politiques, ce qui déforme son message originel.
- Les États totalitaires nient souvent la place culturelle des religions, cherchant à en faire un simple phénomène privé et contrôlé.
- En France, la laïcité cherche à limiter l’influence politique des religions tout en garantissant la liberté de culte.
- À l’échelle mondiale, la lutte contre la haine religieuse prend de l’ampleur, avec des initiatives pour promouvoir le respect, la tolérance et la coexistence pacifique.
Contre les religions : un combat aux multiples facettes et enjeux complexes
Le combat contre les religions n’est pas un simple duel entre croyants et non-croyants. Il s’agit d’un phénomène bien plus vaste qui englobe des dimensions politiques, culturelles et identitaires. Les religions, dans leurs multiples formes, sont souvent au cœur de tensions, mais aussi des cibles de violences et d’instrumentalisations diverses. Ce billet explore ces réalités sous plusieurs angles, du totalitarisme à la laïcité, en passant par l’intolérance identitaire, pour décrypter les enjeux actuels de la lutte contre les religions.
Un combat multiforme face à des religions multiformes
On pourrait croire que la lutte « contre les religions » est simple à définir. Pourtant, elle s’avère bien plus nuancée. En Russie soviétique ou en Europe de l’Est communistes, la religion est rejetée car elle entre en collision avec l’idéologie officielle, qui veut forger un homme nouveau sans croyance en un être supérieur. Le combat dépasse le simple débat intellectuel : il s’accompagne de répressions politiques et parfois militaires contre ceux qui professent la foi.
En Chine, cette même démarche de contrôle et de répression se poursuit. Les autorités chinent obstinément à neutraliser la place des religions, comme avec le bouddhisme tibétain ou l’islam ouïghour, allant jusqu’à interdire plusieurs pratiques et surveiller étroitement les croyants avec une technologie de pointe.
Plus proche de nous, en France, la lutte vise surtout à réduire l’influence politique et intellectuelle de l’Église catholique, avec un combat laïque séculaire, toujours d’actualité, qui s’appuie sur la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État.
Quand la religion devient un prétexte politique
La religion n’est pas seulement victime de répression : certaines violences se fondent sur des revendications religieuses déformées voire détournées. On l’observe dans les attaques islamistes, qui s’emparent d’une image pervertie de la guerre sainte. Ces groupes réinventent la tradition pour justifier leurs actions violentes, effaçant l’histoire et cherchant à masquer leurs échecs en zones de conflit.
Mais cette tendance ne se limite pas à l’islamisme. Le discours religieux se trouve souvent tordu par d’autres extrêmes : juifs ultra-orthodoxes, nationalistes hindous, évangélistes radicaux, extrémistes bouddhistes… Tous contribuent, à leur manière, à déliter le message religieux originel, parfois pacifique, pour le convertir en un outil d’affrontements politiques et identitaires.
L’intolérance identitaire et la perception biaisée des religions

Dans une époque marquée par la désillusion à l’égard des grandes idéologies, les identités se recherchent dans des repères religieux souvent décontextualisés. Cette quête engendre une forme d’intolérance, nourrie par une vision figée et erronée des religions. Les pratiques anciennes sont mises en avant, parfois utilisées comme justification pour des postures rigides, tandis que les évolutions internes des religions, plus tolérantes ou modérées, restent invisibles.
La conséquence ? Un climat d’incompréhension, où le religieux est perçu uniquement comme une source de tensions et d’intolérance, alors que beaucoup d’adeptes cultivent au quotidien des pratiques pacifiques et ouvertes.
La négation de la religion dans son rôle culturel sous les régimes totalitaires
Un phénomène frappant est la volonté des États totalitaires de nier la dimension identitaire des religions. Sous couvert de progrès et de modernité, ils assimileront les croyances à des archaïsmes nuisibles à la société moderne.
En Chine, par exemple, la République de 1912 avait déjà engagé la bataille contre ce qu’elle qualifiait de « superstitions ». Des lieux de culte sont détruits, des rituels interdits, et les ministres de culte surveillés étroitement. Le confucianisme est déthéologisé pour devenir une simple philosophie personnelle.
Paradoxalement, cette même Chine encourage depuis les années 1980 des pratiques spirituelles modernes comme le qigong, tandis que des mouvements spirituels comme le Falungong, nostalgiques d’anciennes valeurs, sont sévèrement réprimés. Cette ambivalence témoigne d’un contrôle étatique complexe du religieux.
L’enjeu territorial et la sinisation des pratiques religieuses
Le contrôle des religions a aussi un parfum géopolitique. En Chine, les provinces du Tibet et du Xinjiang représentent des zones sensibles. Peuplées majoritairement de bouddhistes tibétains et de musulmans ouïghours, ces régions subissent une répression accrue. Depuis 2009, la répression s’intensifie : interdiction d’expressions religieuses non contrôlées, création de camps de rééducation, surveillance omniprésente. L’objectif est clair : imposer la sinisation, c’est-à-dire un alignement culturel et linguistique autour du Parti communiste chinois.
Cette volonté d’assimilation comprend l’apprentissage du mandarin, l’exaltation du Parti et la dénonciation de la religion, perçue comme une source d’”étrangeté” et de concurrence idéologique. Cela révèle que la lutte contre les religions est aussi une lutte pour le contrôle de territoires et des consciences.
Une institution à relativiser : le cas français et le combat laïque
En France, la lutte contre les religions prend une autre forme. Elle vise une institution, l’Église catholique, dont l’influence politique historique est jugée problématique. Le cap est posé par la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, qui veut garantir la liberté de conscience tout en reléguant les religions au second plan.
Cette loi est souvent vue comme une loi d’apaisement. L’État ne subventionne plus les cultes (sauf quelques aumôneries publiques) et reconnaît les Églises comme des corps privés, ce qui limite leur poids politique. Le débat reste vif autour des biens immobiliers publics, notamment les édifices religieux confiés aux associations cultuelles.
Le combat laïque ne cherche pas à éliminer la religion de la société, mais à réduire son emprise politique et intellectuelle. L’objectif est d’affirmer la primauté des règles républicaines, en différenciant clairement le pouvoir politique et l’autorité religieuse.
Vers une lutte globale contre l’intolérance religieuse
Face aux dérives diverses, la communauté internationale, notamment via les Nations Unies, s’est mobilisée pour combattre l’intolérance et la haine religieuse. Dans sa résolution 79/180 adoptée en décembre 2024, l’Assemblée générale recommande une série de mesures concrètes : créer des réseaux de dialogue, former les agents de l’État, dénoncer les discours haineux, criminaliser l’incitation à la violence religieuse.
Ces actions se veulent inclusives et cherchent à promouvoir la liberté religieuse, le pluralisme et la participation égalitaire de tous dans la société. Il ne s’agit pas de nier les religions, mais de garantir qu’elles puissent s’exprimer sans susciter haine ni discrimination.
Le suivi de ces efforts est assuré par des rapports annuels, qui évaluent les progrès et les failles. Ce travail témoigne de la complexité et de la durée nécessaire pour empêcher l’utilisation de la religion comme excuse à la violence ou à l’exclusion.
Alors, pourquoi cette lutte contre les religions persiste-elle ?
Parce que la religion, à la fois facteur d’identité et réalité sociale, est un terrain fertile à la fois pour la foi sincère et les manipulations. La religion cristallise des rêves de justice, mais aussi des peurs et des échappatoires politiques. Son contrôle ou sa marginalisation montrent la difficulté des sociétés à gérer la pluralité, la différence.
Pour avancer, il faut dépasser les clichés et accepter la complexité. Réduire les combats contre les religions à une opposition binaire, c’est ignorer la diversité des situations. Sans ce regard nuancé, on risque de perdre de vue qu’au cœur de ce combat, ce sont des individus et des communautés qui cherchent souvent juste à vivre ensemble en paix.
Quelles pistes pour un futur apaisé ?
- Encourager des dialogues ouverts, interreligieux et interculturels.
- Former les agents publics pour prévenir discriminations et violences.
- Promouvoir une éducation au respect des différences et à la tolérance.
- Reconnaître la place culturelle et identitaire des religions sans laisser s’installer d’extrémismes.
- Renforcer la protection des lieux et manifestations religieuses pour que chacun puisse pratiquer sa foi en sécurité.
Car au fond, le véritable enjeu n’est pas de combattre les religions en tant que telles. C’est de combattre l’instrumentalisation, la haine et l’exclusion que l’on fait parfois porter sur elles. N’est-ce pas là un combat digne de notre époque ?
Sources : Rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme ONU (A/HRC/55/74), Résolution 79/180 de l’Assemblée générale des Nations Unies, textes officiels sur la laïcité française, analyses des politiques religieuses en Chine et en Russie.
Quelles sont les formes principales des combats contre les religions dans les régimes totalitaires ?
Ces combats incluent la répression politique, la destruction de lieux de culte, la surveillance des religieux et l’interdiction des pratiques publiques. En Chine, par exemple, l’État contrôle strictement les expressions religieuses et promeut la sinisation.
Comment la religion est-elle utilisée comme prétexte dans certains conflits politiques et identitaires ?
Des groupes extrémistes détournent des notions religieuses comme la guerre sainte pour justifier des violences. Cela déforme le message religieux et alimente des intolérances identitaires.
Pourquoi le combat laïque en France cible-t-il principalement l’Église catholique ?
Parce que l’Église a historiquement exercé une influence politique et sociale importante. Le combat laïque vise à passer l’Église au second plan pour renforcer la primauté des règles républicaines.
Quelles sont les mesures clés de la loi de séparation de 1905 en France ?
- Liberté de conscience garantie.
- La République ne finance aucun culte.
- Les Églises deviennent des associations privées.
- Les édifices religieux appartiennent aux associations cultuelles.
Comment les États totalitaires justifient-ils souvent la répression des religions ?
Ils considèrent les religions comme archaïques, contraires à la modernité ou comme des entités étrangères menaçant l’unité idéologique et nationale. Cette logique sert à légitimer des mesures de contrôle et de marginalisation.
Quelle est la spécificité du contrôle religieux en Chine depuis les années 2000 ?
Le gouvernement chinois impose une surveillance accrue, notamment dans les régions tibétaines et ouïghoures, interdit les pratiques non contrôlées, et exerce une pression sur les dirigeants religieux pour qu’ils s’alignent sur la politique du Parti communiste.